Petit précis illustré (parfois contrarian) des bienfaits et travers du tout numérique sur nos piètres existences
Format : essai illustré de 280 pages
Sommes-nous encore libres quand nos gestes quotidiens sont guidés par des algorithmes invisibles ?
L’innovation numérique nous émancipe-t-elle vraiment, ou prépare-t-elle en silence un hiver cognitif ?
L’intelligence artificielle, les plateformes et les objets connectés : bienfaits ou pièges dorés ?
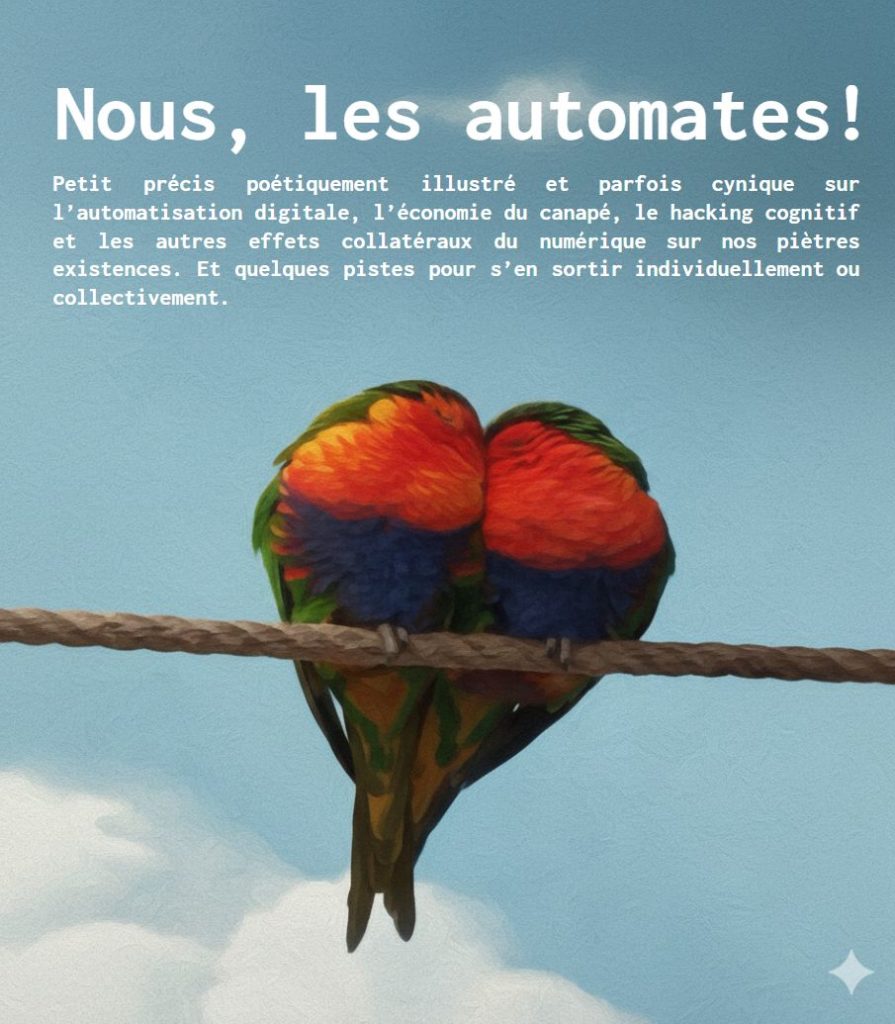
L’acheter :
À mi-chemin entre analyse lucide et poésie satirique, l’auteur explore le grand paradoxe de notre époque : un numérique qui promet l’émancipation mais installe la dépendance, qui ouvre des possibles mais réduit nos libertés intérieures.
En dialogue avec le projet artistique Clear Shadows, dont les images frappent là où les mots hésitent, ce livre est une vigie : une traversée critique et sensible de l’infobésité, de l’économie de la dopamine, de la robotisation douce de nos vies, jusqu’à l’émergence d’un Homo Cubile, confortablement assis dans son canapé connecté.
Ni pamphlet technophobe, ni ode naïve à la Silicon Valley, Tech for Good!? propose un regard rare : sceptique, poétique, contrarian.
Un livre qui bouscule, qui dérange, mais qui ouvre aussi des chemins : sobriété numérique, réinvention collective, art comme refuge, lenteur retrouvée.
Notice de l’auteur
Risque-t-on de finir un jour seuls sur nos canapés, à scroller sans fin, hypnotisés par la lumière de nos écrans ? Peut et doit-on rester optimiste face à cette déferlante du numérique?
Il y a un temps encore très proche, je baignais dans la sphère de la tech et de l’innovation, au contact des start-up, des investisseurs, des décideurs, croyant à la promesse d’une croissance durablement éclairée par la technologie. Puis, un autre temps est venu : celui d’une bascule intérieure. Trop de flux, trop de sollicitations, trop d’écrans. Mon cerveau, saturé (et mon ostéopathe!), m’a rappelé à l’ordre. Il m’a fallu ralentir, observer, digérer. J’ai pesté, râlé, douté. Puis j’ai dessiné, filmé, sculpté, comme pour traduire en gestes créatifs cette inquiétude latente.
Aujourd’hui, le constat s’impose : la tech s’éloigne, chaque jour un peu plus, de son idéal de Tech For Good au service du bien-être et de l’élévation de l’humanité toute entière. Derrière le vernis de l’innovation, je vois un univers où l’éthique vacille à la solde du profit, où l’on flatte quelques égos sur-dimensionnés de superstars de la tech pendant que l’on automatise nos existences à marche forcée, sans rien nous demander. Quelques figures de la tech, devenues quasi-messianiques, occupent le devant de la scène. Mais pendant que leurs récits héroïques captivent, ce sont nos gestes quotidiens qui se transforment en routines automatisées, plus discrètement et plus sûrement. J’observe l’économie de l’attention se transformer en économie du non-partage, l’addiction fleurir plus vite qu’un champ de tournesols, la manipulation algorithmique s’immiscer jusque dans la chimie de nos émotions. Je vois des vies qui se désocialisent, des flux qui remplacent la présence, une robotisation douce qui s’installe au cœur de nos gestes et de nos liens.
Qu’on me comprenne bien : il ne s’agit pas dans cet essai d’ânnoner un réquisitoire contre la technologie et ses dérives. L’innovation a ses vertus, indéniables, et peut porter des promesses d’émancipation réelles. Mais je suis convaincu qu’en ce moment même, nous dérivons collectivement petit à petit, sans même le vouloir et c’est bien là le souci, vers une tech qui aliène plus qu’elle n’élève, qui réduit nos espaces de liberté intérieure plus qu’elle ne les élargit.
Cet essai est né de cette conviction. Il ne propose ni slogans faciles, ni solutions miracles. Plutôt une vigie : un regard sceptique et poétique sur l’addiction digitale, la vacuité des univers virtuels, la manipulation algorithmique, la marchandisation de nos vies et l’érosion de nos émotions. Une traversée critique, parfois rude, parfois plus contemplative ou poétique, pour interroger ce que nous sommes en train de devenir dans ce monde où les machines avancent plus vite que nos consciences.
Si le lecteur y trouve des échos à ses propres doutes, alors ce travail n’aura pas été vain. Sinon, qu’il y voie au moins une tentative d’exprimer ce malaise diffus, ce froid qui s’installe doucement : le signe avant-coureur d’un hiver numérique.
Cet essai ne se veut ni pamphlet politico-économico-socialo satirique, ni catastrophiste, ni technophobe, ni moralisateur ou prosélyte, ni même quoi que ce soit d’autre. Il vise juste à interroger le lecteur sur ses pratiques individuelles qui pourraient potentiellement nuire au collectif ou aux générations futures. Car demain se choisit maintenant.
Il est fondé sur mon expérience en tant que multi-entrepreneur dans le digital depuis 2006 et artiste plasticien depuis 2016 sur des sujets liés à l’automatisation de nos existences via le projet Clear Shadows, qui a vu le jour sous la forme de dessins, sculptures, vidéos, gravures…
Clear Shadows (https://www.clear-shadows.com) n’est pas une démarche esthétique détachée du réel : c’est un projet profondément engagé. Les images ici réunies assument leur fonction de choc. Elles ne prétendent pas expliquer, ni convertir, ni prêcher, ni même argumenter avec la rigueur d’un essai : elles visent plus directement, elles parlent au cerveau reptilien, à l’instinct, à l’émotion brute, quitte à flirter avec la dystopie et l’exagération béante. Là où un long discours s’épuise dans les nuances, une seule image peut déclencher un sursaut, une inquiétude, une conscience. Ces visuels sont conçus comme des électrochocs, des signaux d’alerte dans le flux continu des images numériques.
Bien sûr, cette charge peut être anxiogène. Mais l’art n’est-il pas justement là pour déranger, secouer, faire voir ce que l’on refuse de regarder ? Les œuvres de Clear Shadows provoquent une inquiétude nécessaire, en contraste avec le texte de l’essai qui les accompagne. Car l’écriture, elle, nuance, met en perspective, ouvre un espace de recul et cherche souvent le contre-pied et à mettre en balance les deux forces technophiles et technophobes qui s’opposent dans ces débats. Entre le regard frontal des images et le travail réflexif du texte, s’installe un dialogue : celui de la secousse et de l’analyse, du cri et de la pensée. Ensemble, ils invitent à ne pas détourner les yeux.
Résumé de l’essai
Nous vivons au cœur d’un paradoxe tranquille. Jamais l’humanité n’a disposé d’autant d’outils pour comprendre le monde, communiquer, apprendre, créer, coopérer. Et pourtant, jamais elle n’a semblé aussi distraite, fragmentée, épuisée, incapable de soutenir une attention longue, un doute fécond, une pensée lente. Le progrès technique avance à une vitesse que nos consciences ne suivent plus. Il ne s’impose pas par la contrainte, mais par la commodité. Il ne domine pas par la force, mais par l’habitude. L’automatisation ne nous écrase pas, elle nous soulage. Et c’est précisément là que réside le danger.
Le digital n’est plus un outil extérieur que l’on saisit puis que l’on repose. Il est devenu une atmosphère. Une couche continue, invisible, qui enveloppe les gestes, les relations, le travail, le désir, le repos. Il n’y a plus de rupture franche entre le connecté et le non-connecté, seulement des intensités variables. L’exposition commence dès le réveil, se prolonge dans les transports, infiltre le travail, colonise les temps morts, déborde sur les soirées, accompagne le sommeil. Les temps passés devant un écran ne cessent d’augmenter. L’esprit est sollicité en permanence par des signaux courts, lumineux, fragmentés, conçus pour capter, engager, retenir, relancer. Cette saturation, amplifiée avec une infobésité omniprésente, ne résulte pas d’un choix pleinement conscient. Elle est acceptée tacitement, selon un contrat implicite jamais lu, jamais négocié.
De cette exposition permanente naît une routine. Les gestes se répètent. Les réflexes s’installent. Le téléphone devient une extension du corps. Les notifications structurent le temps. Les plateformes ne se contentent plus d’héberger des contenus ou des échanges. Elles organisent l’accès au réel, hiérarchisent l’attention, définissent ce qui mérite d’être vu, lu, désiré, ignoré. Elles ne contraignent pas, elles suggèrent. Elles ne forcent pas, elles orientent. Une main invisible agit en permanence, non pour imposer des choix, mais pour rendre certains comportements plus probables que d’autres. Ce qui apparaît devient légitime. Ce qui disparaît cesse d’exister.
Ce qui devait simplifier la vie commence à la remplir jusqu’à la dernière seconde. L’illusion d’efficacité masque une dépossession progressive. On délègue sa mémoire, son orientation, sa curiosité, parfois même son jugement. Les algorithmes anticipent, recommandent, suggèrent, optimisent. Ils promettent de faire gagner du temps, mais redéfinissent silencieusement ce qu’il est pertinent de faire de ce temps. L’économie de l’attention s’est muée en économie de la dopamine, puis en économie de la dépendance. La Tech for Good des origines, portée par des idéaux d’émancipation et de partage du savoir, s’est lentement dissoute dans des modèles fondés sur la captation, la rétention et la monétisation des comportements. Le bien est devenu utile, l’utile indispensable, l’indispensable addictif.
Dans ce contexte, l’intelligence artificielle ne constitue pas une rupture radicale, mais une accélération. Elle n’est pas un aboutissement, mais une étape supplémentaire dans un processus déjà engagé. Les IA génératives absorbent, synthétisent, reformulent, répondent avec une assurance troublante. Elles produisent du langage sans vécu, du sens sans expérience, des réponses sans mémoire. Elles recyclent un web déjà saturé de contenus redondants, nourri par des fermes de textes, du slop informationnel produit à la chaîne pour remplir des intentions de recherche plutôt que transmettre une connaissance. La médiocrité devient abondante, fluide, peu coûteuse. La singularité se dissout dans la moyenne statistique. La pluralité des points de vue se réduit à une réponse unique, présentée comme évidente.
Cette simplification généralisée rassure. Elle fatigue moins. Elle demande moins d’effort. Mais elle appauvrit. À force de déléguer la formulation, l’analyse, la synthèse, on risque d’atrophier les muscles cognitifs fondamentaux : la mémoire, le raisonnement, l’écriture, la capacité à douter, la capacité à apprendre. Le confort cognitif devient une norme. L’esprit critique, une option. L’apprentissage se confond avec l’accès immédiat à une réponse. La synapse, lente, imparfaite, vivante, avance par hésitations, erreurs, détours. Le silicium, rapide, fiable, indifférent, calcule sans fatigue ni souvenir. En confiant toujours plus de tâches cognitives à des machines sans vécu, nous risquons de remodeler nos propres attentes : moins de nuance, moins de contradiction, moins d’ambiguïté.
Les effets ne sont pas seulement cognitifs. Ils sont physiologiques, émotionnels, sociaux. Les écrans perturbent les rythmes biologiques, fragmentent le sommeil, installent des cycles artificiels de stimulation et d’effondrement. Les corps se sédentarisent. L’immobilité devient la norme. L’économie de la paresse glisse vers une économie du canapé, où tout doit être accessible sans se lever, sans attendre, sans effort. Commander, regarder, apprendre, se divertir, rencontrer, consommer, presque aimer. Le corps devient une contrainte à optimiser, le mouvement une anomalie.
Les relations se médiatisent, se scénarisent, se quantifient. Le phubbing, qui consiste à préférer regarder son téléphone que participer aux conversations, s’installe comme une pratique banale. Être physiquement présent ne signifie plus être attentif. Le regard glisse vers l’écran, la conversation se suspend, l’autre attend. La présence se fragmente. La nomophobie, cette angoisse d’être séparé de son téléphone, révèle à quel point l’objet est devenu un organe central de la vie quotidienne. Couper n’est plus un simple choix. C’est une perte de repères, parfois une source d’anxiété.
Les réseaux sociaux fonctionnent comme des miroirs déformants. Ils exacerbent la comparaison, l’envie, l’orgueil, la colère. Ils transforment chaque émotion en signal exploitable. Rien n’est jugé. Tout est mesuré. Chaque like, chaque partage, chaque seconde passée nourrit une boucle d’optimisation continue. L’addiction n’est pas une pathologie marginale. Elle est la conséquence logique d’un système fondé sur l’exploitation méthodique des biais cognitifs humains. Aversion à la perte, peur de manquer, récompense variable, validation sociale. Tout est connu, documenté, testé.
Sur le plan économique, cette logique produit un autre phénomène : l’enshittification progressive des plateformes. Ce qui commence comme un service utile et séduisant se dégrade lentement à mesure que la valeur se déplace de l’utilisateur vers les annonceurs, puis vers l’extraction maximale de données et d’attention. L’expérience se détériore, les contenus s’appauvrissent, la frustration augmente. Mais la dépendance maintient l’usage. Sortir devient coûteux.
L’automatisation transforme également le travail en profondeur. Elle ne supprime pas mécaniquement tous les emplois, mais rend visibles des fonctions devenues obsolètes, fragilise des métiers intermédiaires et reconfigure les compétences attendues. Elle crée des professions sentinelles, tout en laissant se diffuser une insécurité silencieuse. Les bénéfices se concentrent. Les coûts se diffusent. La productivité promise dépasse souvent la productivité réelle. Là encore, le mouvement est discret, progressif, rarement débattu à la hauteur de ses enjeux.
Sur le plan matériel et géopolitique, cette dématérialisation repose sur des infrastructures lourdes, énergivores, fragiles. Centres de données, flux, câbles, silicium. Une dépendance totale à des architectures invisibles, centralisées, concentrées. L’hiver numérique ne relève pas d’une apocalypse soudaine, mais d’un refroidissement lent. Une perte progressive de diversité cognitive, une fragilisation des équilibres, une exposition accrue aux ruptures systémiques. Un hiver qui s’installe sans bruit.
Rien de tout cela ne relève d’un complot. Tout relève d’une optimisation rationnelle poussée à son terme. Un grand nombre de ces désagréments ne sont généralement que des effets de bord. C’est précisément ce qui rend la situation difficile à saisir. La main invisible du digital n’est pas malveillante. Elle est efficace. Elle n’a pas besoin d’intention. Elle fonctionne. Elle semble parfois inarrêtable.
Pourtant, le numérique porte aussi des bienfaits incontestables. Accès élargi au savoir, coopération, médecine, recherche, mobilité, créativité. Ces acquis sont réels, irréversibles. La question n’est pas de refuser la technologie, mais de refuser l’abandon. De réintroduire de la souveraineté cognitive ans tomber dans la technophobie primaire. De redonner de la valeur à l’attention, à la lenteur, à la présence, aux constructions communes. De réapprendre à ménager des zones sans flux, sans notification, sans projection sociale. Non par nostalgie. Par lucidité.
L’éducation devient centrale. Non pour lutter contre l’IA, mais pour renforcer ce qu’elle ne reproduira pas. Le doute, l’esprit critique, la créativité non standardisable, l’apprentissage profond. Apprendre à apprendre plutôt qu’accumuler des réponses.
L’art, enfin, conserve une fonction irremplaçable. Il ne démontre pas. Il révèle. Il rend visible ce que les systèmes cherchent à rendre transparent. Il agit comme un choc, un ralentisseur, un miroir. Face à des architectures invisibles, l’image peut parfois frapper plus juste qu’un discours.
Rien n’est écrit d’avance. L’automatisation n’est pas une fatalité. Elle est un processus, donc un espace de choix. Le plus grand risque n’est pas la domination des machines, mais l’abdication progressive des consciences. Demain ne se décide pas dans un futur abstrait. Il se choisit maintenant, dans les gestes ordinaires, dans l’attention que nous acceptons de céder ou de préserver.
Si ce texte dérange, c’est qu’il touche à une zone sensible. S’il inquiète, c’est peut-être qu’il met des mots sur un malaise déjà là. Il n’appelle ni à la panique ni à la morale. Il invite simplement à regarder sans détour ce que nous sommes en train de devenir, à ralentir suffisamment pour voir, à douter suffisamment pour rester humains.
